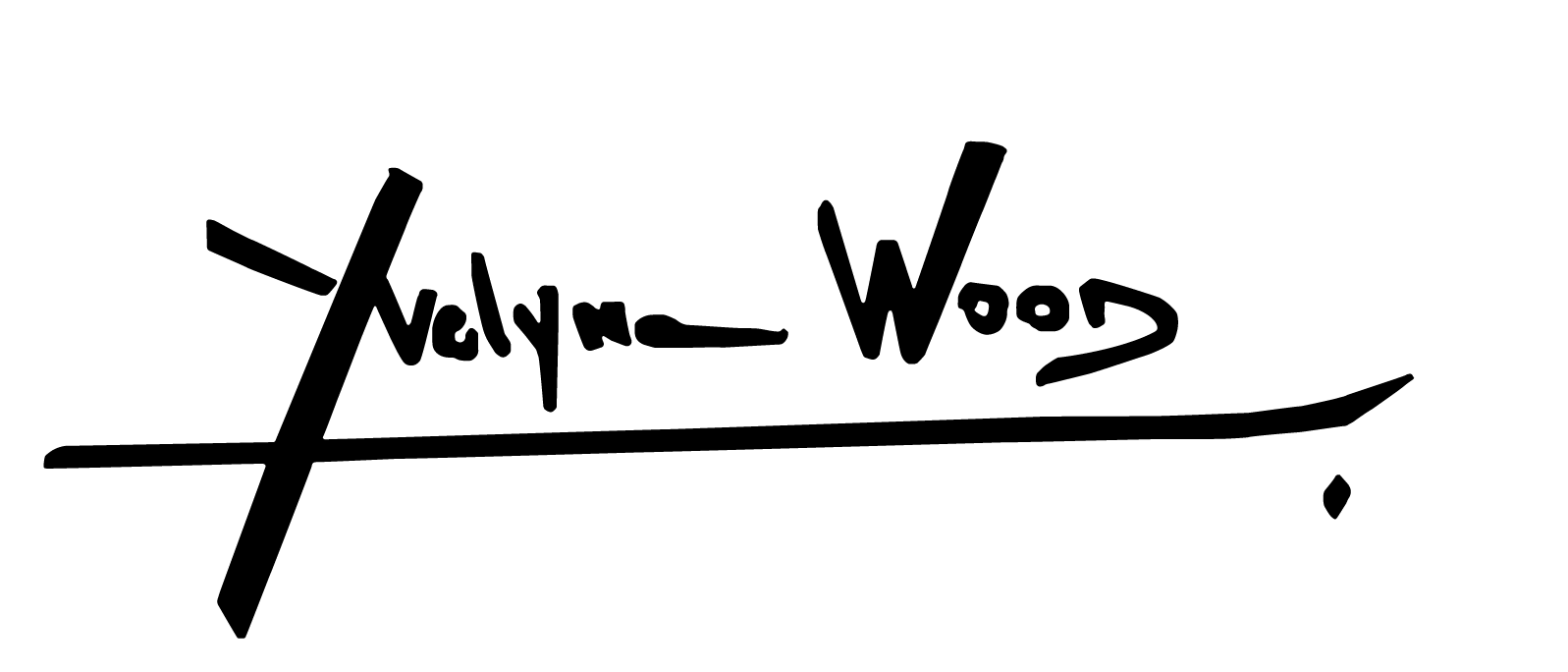Chemin de fer, chemin de feu, chemin de fin… Entendez-vous dans la nuit les ahanements de la locomotive coulissant sur les rails ? Son souffle haletant dit qu’elle se donne le courage d’aller jusqu’au bout. Car il y a un bout, en effet. On sait que deux parallèles se rejoignent toujours quelque part si l’on regarde assez loin. Elles se rejoignent, indique notre mémoire, en un décor de gare judicieusement appelée terminus, sur ce sol fini où le métal soudain inutile des voies se tricote barbelé.
Chaque être humain s’efforce à sa façon et selon ses maigres moyens de contrecarrer la méchanceté de l’inéluctable. Ich packe meine Bibliothek aus, dit par exemple Walter Benjamin en 1931, « Je déballe ma bibliothèque ». Dans ces « 469 kilogrammes », Benjamin semble placer l’espoir qu’ils vont lester une existence dont il sait bien qu’elle est un glissement de tous les jours vers une fin qui sera poignante.
Autre presse-papiers du désespoir : en un geste poétiquement inspiré des résistances d’antan, Yvelyne Wood s’en prend au vecteur des armements et des condamnés, le rail. Elle choisit le dégorgement de livres et d’écrits personnels à même la voie, sur le ballast et les traverses, qu’ils recouvrent et tentent d’effacer à la vue. Lignes des mots sur lignes de mort, la montagne de papier s’érige en barrage contre l’acier grondant. Dérisoire ? Bien au contraire. Cela veut dire que la matière dont on fait la mémoire est la plus forte, en ce sens qu’elle interdit l’oubli.
Une puissance aussi invincible, la disparition programmée du papier n’en sonnera pas la fin : qu’il soit oral, manuscrit, imprimé ou volatil, le livre échappe à toutes les contingences et à toutes les oppressions, ainsi que nous l’avons constaté dans notre biographie des bibliothèques violentées.
Brûler des livres ne produit ni lumière ni chaleur. C’est pourquoi les organisateurs d’autodafés y mettent toujours une petite fanfare, sur le côté. Mais ils ignorent que la perspective des textes est la seule qui ne se termine jamais.